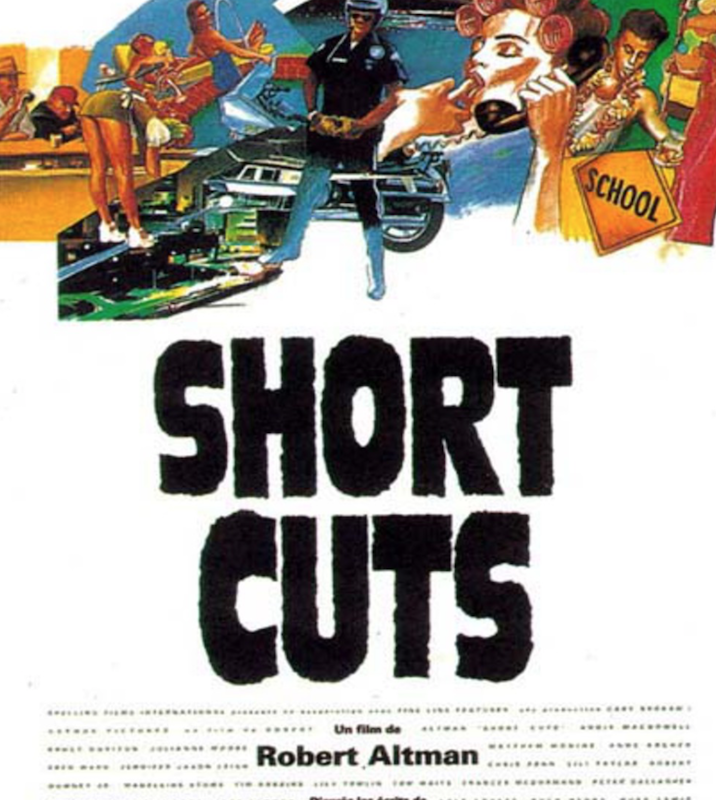Vous vous souvenez du film de Robert Altman, Short Cuts ?
Sorti en 1993, ce film choral racontait le destin mêlé de nombreux habitants de Los Angeles, juste avant un terrible séisme. La scène qui m’avait le plus marquée se déroulait durant le tremblement de terre. On y voyait un policier, hurler dans un porte-voix à destination de la population « tout est sous contrôle » alors que tout était chaos et que personne ne l’écoutait.
Et bien c’est un peu le sentiment que j’ai eu face aux candidats de ces primaires du PS.
Alors que le monde change, alors que notre système politique se décompose, les dirigeants socialistes et les représentants des partis sans réelle existence, qui sont là pour donner un semblant de diversité à une primaire bien endogame, sont toujours aussi hors-sol : leur microcosme ressemble à une goutte de lait qui se prendrait pour la voie lactée.
Cela donne parfois un côté joliment surréaliste au débat. Et la réflexion qui vient le plus souvent à l’écoute des Hamon, Peillon, Montebourg et autres impétrants est : « Mais dans quel monde vivent-ils ? ». Il y a quelque chose de comique de voir ces ex-ministres expliquer qu’ils ne veulent pas d’une médecine ou d’une école à deux vitesses quand le moindre citoyen sait que non seulement on y est déjà mais que notre école et notre médecine sont même à 3 vitesses : l’effondrement institutionnel créant des phénomènes d’évitement social et de distinction territoriale qui font que le niveau des garanties collectives baissant, c’est dans la capacité à recourir au privé que se joue les perspectives d’avenir des enfants dans l’éducation ou la rapidité de la prise en charge dans la santé.
Ils se voudraient nos représentants mais ressemblent plus à des bureaucrates qui jugent de la réalité en fonction des rapports administratifs et des statistiques sans jamais ne se soucier de ce que pensent les Français, même quand ceux-ci le leur signifient vertement. A voir certains numéros d’autosatisfaction nombriliste, notamment de la part des 2 anciens ministres de l’éducation qui n’ont guère brillé par leurs résultats, on est d’autant plus étonné.
Pour qui a des enfants à l’école de la République, ce n’est pas dur de voir que les parents ne sont pas satisfaits. Ni de l’organisation de celle-ci ni des programmes. Les résultats des évaluations internationales et le constat que l’école ne réduit pas les inégalités mais les reproduit, confirme que l’on n’est pas là devant un ressenti mais devant une réalité. Quant au fait qu’il y ait une tentative d’exode massif du public vers le privé au niveau du collège, cela devrait questionner ces ministres qui pourtant se pavanent en se félicitant de leur réforme du collège.
Bref dans ce grand bal des infatués d’eux-mêmes, seul Manuel Valls parait être conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons et met en situation les enjeux qui pèsent sur notre pays. Pour les autres candidats susceptibles d’émerger à l’issue du débat, nous ne sommes pas en état d’urgence, rien ne s’est passé en 2015/2016 et tout va très bien dans le meilleur des mondes.
Le peuple, conscient des tensions intérieures comme extérieures, attend Churchill mais à la primaire du PS, c’est Pangloss et Diafoirius qui arrivent. Ils s’allient même pour taper sur le seul républicain d’entre eux (encore que François de Rugy a été aussi impeccable que Valls sur les questions de laïcité). Triste bilan.
Mais pire que tout, là où Valls assume l’exercice du pouvoir (alors que défendre le bilan de Hollande n’est pas un cadeau), les autres semblent illustrer cette phrase d’Aquilino Morel parlant de la présidence de François Hollande : « il voulait être élu mais il ne voulait pas gouverner ».
Prenons le débat sur l’école par exemple. Outre qu’aucun d’entre eux ne semble capable de se remettre en cause, Vincent Peillon a illustré une nouvelle fois ce que peut être l’impasse d’une gauche qui désire le pouvoir, pour se faire une fierté de refuser de l’assumer.
Un exemple m’a frappée. Interrogé sur le prédicat, réforme éminemment stupide que connaissent tous les parents qui ont un enfant en CE2, Peillon monte sur ses grands chevaux et fait aux journalistes un laïus en forme de plaidoyer geignard sur ses grandes qualités de ministre, présente comme une fierté suprême le fait de refuser d’assumer ses responsabilités. Il explique ainsi que la commission des programmes est indépendante et que c’est sa grande fierté. Mais quelle est la légitimité d’une telle commission ? A quoi sert un ministre qui délègue sa responsabilité à des commissions ? Qui se lie à la décision de ceux qui n’ont aucune légitimité démocratique ?
Notre école est l’école de la République. Elle n’est pas neutre. Elle a une dimension citoyenne et porte des principes, des idéaux et des valeurs. Elle participe à l’élaboration de notre contrat social, elle oeuvre à la construction du monde commun que doit être notre sphère publique. C’est à l’Etat de prendre ses responsabilités dans ce cadre et s’il est toujours utile de savoir s’entourer et d’écouter ceux qui sont sur le terrain ou qui ont une expertise technique, se dépouiller de son devoir de décision, c’est vouloir jouir de la fonction sans en accepter les exigences et les contraintes. Quand on donne une majorité pour agir à un gouvernement, ce n’est pas un amour que l’on déclare mais une responsabilité que l’on confie. Que ceux que l’on désigne pour l’exercer n’aient de cesse de la confier à des instances non démocratiques et qui ne sont responsables d’aucune des conséquences de leur décision ne choque pas alors que cela devrait nous indigner.
Cela dit quelque chose aussi de la façon dont certains hommes politiques se voient. S’ils pensent que la politique est sale, qu’ils sont médiocres et que leurs décisions seront inappropriées, ils devraient juste ne pas se présenter : s’ils ne se font pas confiance, qu’ils ne sollicitent pas alors la nôtre. Un ministre de l’éducation nationale n’est pas là pour organiser les matchs de la première division des lobbys des édificateurs de programme et remettre le trophée aux influenceurs les plus efficaces. Il a à les écouter, à aller au plus près du terrain et à assumer son rôle dans l’incarnation et la transmission des valeurs collectives. Quand un homme est ministre et qu’il n’est même pas capable de comprendre cela, est-ce bien raisonnable de lui confier la présidence de la république dans l’absolu ? Et la question prend une acuité lancinante quand les temps sont durs.
Que dire d’un Benoit Hamon qui réussit une percée médiatique grâce à un coup de communication et une proposition aussi irréfléchie qu’inapplicable en l’état de la société et qui bâtit une crédibilité auprès des journalistes en s’exonérant de tout rapport avec le réel. A-t-on besoin de tels politiciens alors que nous sommes pris pour cible et que la violence ne cesse de monter dans notre pays ? Veut-on vraiment que nos représentants aient le déni comme vision et les accommodements déraisonnables comme pratique ? Quant à Arnaud Montebourg, c’est le courage qui lui aura manqué tout au long de cette pré-campagne. De l’évitement du mot même de laïcité à Frangy, jusqu’à ses circonvolutions pour éviter de prendre une position ferme dès qu’un sujet est lié aux questions de sécurité, de laïcité ou de lutte contre l’islamisme, il n’accepte ce qui est clivant que lorsque c’est sans danger : sur l’Europe par exemple, tellement déconsidérée dans l’esprit des Français que toute proposition devient entendable (ce qui ne veut pas dire qu’Arnaud Montebourg ne dise que des bêtises à ce sujet, ce n’est pas le cas, juste que le sujet peut être clivant mais reste sans grand risque politique). Or aujourd’hui, le courage est une des vertus des dirigeants qu’un peuple attaqué est en droit d’attendre voire d’exiger.
Le seul qui assume cette dimension du politique, au moins dans le verbe, est Manuel Valls. Il fait le job mais il a tout le monde contre lui. Il doit assumer le bilan d’un Hollande qui a déconsidéré la fonction et, en tant que premier ministre sortant, voit la fermeté de son discours remise en cause par la réalité de la façon dont le pouvoir a été exercé pendant 5 ans. Alors que, si je ne doute pas de l’authenticité des convictions républicaines de Manuel Valls, c’est à la pusillanimité et au manque de conscience historique comme politique d’un président et d’une équipe gouvernemental sur tout ce qui avait trait à la laïcité, à l’égalité femmes/hommes et à l’exercice du pouvoir en général que l’on doit la déconsidération totale de la gauche de gouvernement. Manuel Valls aurait gagné à démissionner à la énième avanie qu’ils lui ont fait subir sur ces sujets (rappelez-vous de l’épisode avec Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la Laïcité), mais il a été plus loyal que cohérent avec lui-même et c’est bien dommage.
Il n’en reste pas moins qu’au PS, il est le seul à être conscient de ce qu’affronte notre pays et le seul à témoigner de ces convictions républicaines, laïques et féministes. Le seul à avoir identifié ceux qui nous attaquent et à avoir compris que les militants de l’Islam politique ne se réduisent pas à ceux qui posent des bombes mais à ceux qui sapent les fondement de notre société à coup de propagande séparatistes et de revendications raciales et religieuses. Son discours d’hier au Trianon dans le XVIIIeme était impeccable sur ces questions.
Lui a compris que c’était notre contrat social qui était attaqué dans ses fondements, notre monde commun qui se délitait sous nos yeux et la garantie d’un avenir de paix pour nos enfants qui devenait de plus en plus incertain. Il est redevenu un politique, là où les autres sont à la quintessence du gestionnaire. Ils emballent une posture de techno d’une logorrhée politique mais cela s’arrête hélas là.
Quoi qu’il en soit ce qui était le plus évident au terme de ces débats, c’est que la machine PS est cassé et que le résultat de cette primaire pourrait accélérer sa décomposition. Car il y a bien deux gauches irréconciliables : l’une qui s’exonère de l’exigence de vérité et qui préférera toujours avoir tort avec Sartre que raison avec Aron et la gauche républicaine qui préfère faire œuvre de raison avec Aron que justifier tous les aveuglements et toutes les trahisons, soi-disant parce qu’il ne faut pas désespérer Billancourt mais surtout parce qu’elle se refuse à assumer ses responsabilités.